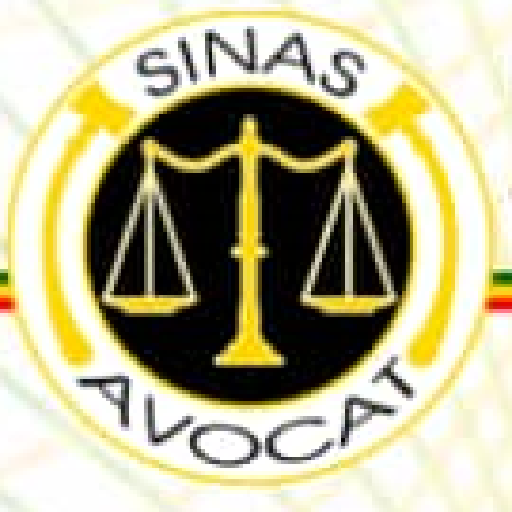LE DROIT DE RÉTENTION EN TANT QUE SURETÉ : FICTION OU RÉALITÉ
Les sûretés on le sait, ajoutent aux créances une facette miroitante, à savoir la sécurité juridique.
En pratique, les juristes ont lentement dessiné les sûretés appelées garanties pour réduire les risques d’un défaut de paiement, en donnant au créancier, sur les biens du débiteur ou d’un tiers, une action prioritaire (sûreté réelle) ou supplémentaire (sûreté personnelle).
Les sûretés réelles mobilières au nombre desquelles le droit de rétention sont, de loin les sûretés les plus nombreuses et les usitées dans la pratique.
L’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sûretés a définitivement conféré à cette dernière sûreté son caractère de sûreté légale.
Historiquement, les sûretés avec dépossession sont apparues les premières. Facile à réaliser, la dépossession du débiteur, suivie de la remise du bien au créancier remplissait deux fonctions essentielles : d’une part, permettre au créancier d’être assuré que son débiteur ne dissiperait pas le meuble; d’autre part, la dépossession servant de mesure de publicité auprès des créanciers du débiteur qui ne pourront ignorer que le bien ne fait plus partie du patrimoine de leur obligé, donc leur gage général, puisqu’il en était sorti.
Sous l’empire de la loi de l’OHADA, deux types de sûretés illustrent parfaitement cette garantie : le gage et le droit de rétention.
Le droit de rétention qui retient notre attention dans le cadre de la présente note permet à un créancier, qui détient légitiment un bien de son débiteur, de le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû (article 67 de l’Acte Uniforme portant organisation des Sûretés).
Ainsi, un prestataire (garagiste) sur une chose (véhicule ou moteur) peut retenir celle-ci tant que le débiteur du coût de son intervention n’en aura pas acquitté le montant intégral.
Le droit de rétention est un vestige de justice privée dans la mesure où le créancier se passe de l’accord du débiteur ou d’une décision de justice pour utiliser ce droit.
La nature juridique du droit de rétention donne lieu à débat : c’est en cela que l’on pourra légitimement s’interroger : le droit de rétention est-il une sûreté fictive ou une « sûreté réelle » ?
Dans le cas ou le créancier exerce son droit de rétention sur un bien appartenant à son débiteur, celui-ci ne peut faire lâche prise au créancier que s’il lui offre une sûreté réelle et non personnelle telle qu’une caution ou une garantie à première demande.
Dans tous les cas, la loi exige que le créancier exerce son droit de rétention avant de saisir la chose détenue mais en présence de saisies pratiquées avant que le créancier n’ait exercé ce droit, il ne peut plus l’utiliser.
Dés lors, il en résulte que si le droit de rétention ne peut s’exercer sur un bien déjà saisi, il ne peut laisser la place à une saisie ou plutôt à une opposition de la part du créancier.
Pour vaincre la résistance d’un débiteur, le créancier rétenteur de son bien qui ne reçoit pas paiement de sa créance, peut après signification faite à celui-ci et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de gage.
Sur cette base, le créancier rétenteur convertit son droit de rétention en droit de gage en passant à la réalisation de sa sûreté.
Le créancier rétenteur ne peut exercer ses droits de suite et de préférence qu’en suivant la procédure prévue pour la réalisation du gage.
Il apparaît dès lors que la loi fait du droit de rétention une et achevée de portée générale même s’il apparaît très clairement que cette « sûreté réelle » en apparence ne se réalise que par combinaison des dispositions applicables à la réalisation du gage, cette autre « sûreté réelle »